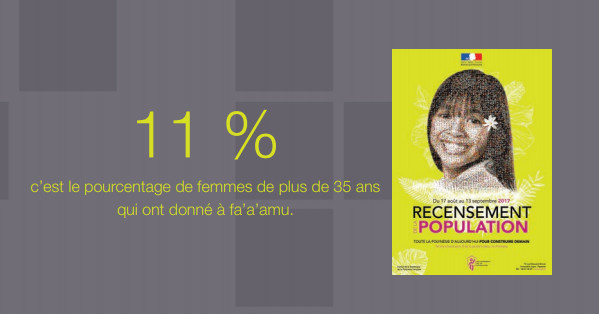L’étude publiée par l’ISPF tente « de cerner les caractéristiques socio-démographiques et les origines géographiques des femmes donnant et accueillant des enfants fa’a’amu, grâce aux données du recensement qui permettent d’observer ce phénomène. »
En 2012, l’ISPF a recueilli des informations auprès de l’ensemble des femmes de la Polynésie française âgées de plus de 14 ans (nées avant le 17 août 2003) sur l’éventualité d’avoir « donné des enfants à fa’a’amu » et également sur le fait « d’avoir actuellement des enfants à fa’a’amu ».
L’institut relève d’abord une « véritable persistance du fa’a’amura’a dans la société polynésienne ». La proportion de celles qui ont un jour donné un enfant à fa’a’amu se maintient à un niveau qui oscille autour de 11 % pour les femmes interrogées à partir de 35 ans et ce, quel que soit leur âge.
Cette stabilité subsiste malgré l’exceptionnelle baisse de la fécondité qui est passée de 7 enfants par femmes (au sens de l’indicateur conjoncturel de fécondité) dans les années 1950 à 2 enfants par femmes en 2012.
> Qu’en est-il des femmes qui adoptent ?
Les femmes déclarant recevoir des enfants à fa’a’amu sont elles aussi plus souvent sans diplômes (64 %) que l’ensemble des femmes du même âge (47 %).
À l’inverse si 13,2 % des femmes de plus de 55 ans ont au moins leur BTS, elles ne sont que 5 % à avoir ce diplôme parmi celles qui accueillent à fa’a’amu un enfant.
Les femmes de plus de 55 ans résidant aux Îles Du Vent reçoivent moins d’enfants à fa’a’amu que celles des autres archipels, or c’est aussi aux Îles Du Vent que l’on trouve la population la plus diplômée. Les femmes concernées sont principalement originaires de Polynésie (97 % des accueillantes), en particulier, les femmes originaires des Marquises et des Australes se distinguent avec des taux de 34,4 % et 36,4 % contre 20,9 % en moyenne.
Les taux sont également forts, surtout en regard de la faible taille de ces communautés, pour les femmes originaires d’Océanie (18 %), de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie (11,7 %), des autres COM et DOM (9,6 %) et enfin d’Amérique (9,1 %).
Par ailleurs, la situation économique des femmes actives s’est dégradée dans ces territoires, augmentant de fait la pression économique sur les familles de grande taille. Souvent associé à des considérations affectives, il est probable que confier et donner un enfant s’accompagne également de considérations économiques.
Retrouvez l’étude complète en cliquant ICI